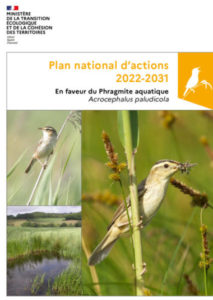Télécharger le pna

Plan National d’Actions
Qu'est ce qu'un Plan National d'Actions ?
Un plan national d’actions (PNA) est un outil stratégique opérationnel (5 à 10 ans) pour les espèces menacées. L’objectif est d’assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces sauvages menacées ou d’intérêt particulier. Cet outil est mobilisé lorsque les autres politiques publiques environnementales sont jugées insuffisantes pour aboutir à cet objectif. Il est porté par l’État (ministère de la Transition Ecologique) et est coordonné par une DREAL.
Il existe deux types de plan d’actions :
- le plan national d’actions pour le rétablissement
- le plan national d’actions pour la conservation
La stratégie d’un PNA est :
- organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées ;
- mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs habitats ;
- informer les acteurs concernés et le public ;
- faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques.
Pour en savoir plus : site du ministère de la Transition Ecologique
Historique de la Conservation du Phragmite aquatique en France
En France les travaux sur le Phragmite aquatique ont débuté dans les années 2000. La région pionnière en la matière fut la Bretagne. Un premier LIFE « Conservation du Phragmite aquatique en Bretagne 2004-2009 » (n°LIFE04NAT/FR/000086REV) a vu le jour sur la gestion des habitats de trois sites.
Fort des résultats locaux de ce LIFE, l’Etat a mis en place un premier plan national d’actions (2010-2014). La mise en place de ce PNA est également une réponse à la signature par la France, en 2010, du Mémorandum d’entente international (de 2003). Cela marque sa participation effective au Plan International d’Actions en faveur du Phragmite aquatique établi en 2008.
Ce premier PNA s’est décliné en trois principaux objectifs :
- Augmenter la surface des habitats du Phragmite aquatique sur les haltes migratoires,
- Améliorer la connaissance du fonctionnement de la migration en France,
- Participer à la conservation globale de l’espèce.
La DREAL Bretagne est le pilote national de ce plan et Bretagne Vivante en est l’animateur national.
A la fin de ce premier PNA, le bilan a permis de montrer les importantes avancées, notamment en terme de connaissance de l’utilisation du territoire par l’espèce. Mais il a également montré que tous les objectifs n’avaient pu être atteint. Ce constat a été validé par le CNPN qui a émis un avis favorable à la poursuite de la conservation du Phragmite aquatique en France avec un PNA II conservation (10 ans).
PNA II (2022-2031)
Enjeux et objectifs
Le plan national d’actions en faveur du Phragmite aquatique 2022-2031 a pour objectif la mise en place de la stratégie nationale de conservation de cette espèce. Il fait suite à un premier PNA (2010-2014) qui a largement contribué à la connaissance des sites utilisés en migration en France et à la caractérisation des habitats recherchés.
L’enjeu de ce plan national d’actions est d’agir sur une espèce uniquement en transit en France et dont les causes de déclin sont disséminées sur son aire de répartition mondiale. Une baisse des effectifs mondiaux ne signifie pas nécessairement que les actions menées en France n’apportent pas de résultats. L’action principale de ce nouveau PNA est de constituer et conserver un réseau pérenne de haltes migratoires fonctionnelles pour le Phragmite aquatique en France. Participant ainsi à l’objectif final du Plan International d’Actions qui ambitionne de sortir le Phragmite aquatique de la liste rouge de l’UICN.
Pour que le réseau de sites réponde aux besoins du Phragmite aquatique, deux éléments sont pris en compte :
- La densité de sites, et
- Les ressources alimentaires.
Durant ce second PNA, l’effort devra être mis sur :
- La compréhension de la fonctionnalité des sites : sont-ils des sites de halte, c’est-à-dire des zones où l’individu est en mesure de refaire ses réserves de graisse pour atteindre la halte suivante ? Ou seulement des sites d’escale ?
- Le Phragmite aquatique est une espèce insectivore (Hemery et al., 2018 ; Musseau et al., 2014a ; Provost et al., 2011), ce sont donc les ressources d’arthropodes proies qui sont importantes. Pour des raisons pratiques, on peut indirectement évaluer les ressources alimentaires d’un site au travers des surfaces d’habitats favorables (habitats d’alimentation). Mais il faut connaître la relation entre ces habitats et leur richesse en arthropodes, en fonction de la latitude, des conditions météorologiques, et aussi des modes de gestion. En effet, les arthropodes peuvent réagir plus rapidement que la végétation en fonction de changements ponctuels.
La standardisation des données de connaissance est un travail entamé, et dont l’achèvement est un des enjeux fort de ce nouveau PNA.
La survie de l’espèce en migration est tout aussi cruciale qu’à d’autres étapes de son cycle annuel. C’est particulièrement le cas au printemps, lorsque la migration est la plus rapide et que la qualité des haltes est par conséquent indispensable à son bon déroulé et à une arrivée en bonnes conditions physiques sur les sites de nidification (Zucca, 2021). En migration pré-nuptiale, l’espèce semble moins utiliser les sites en France. Il est possible aussi qu’elle soit moins détectée ou passe plus rapidement, l’impératif biologique étant de rejoindre les zones de nidification le plus rapidement possible. Des questions demeurent à ce sujet, qui font partie des enjeux de ce nouveau PNA.
Axes de travail
| A : Préserver et développer les habitats du Phragmite aquatique sur les sites de migration | 1 : Suivre et évaluer les sites de migration |
| 2 : Gérer favorablement les habitats du Phragmite aquatique sur les sites de migration post-nuptiale | |
| 3 : Approfondir la connaissance et gérer favorablement les habitats du Phragmite aquatique sur les sites de migration pré-nuptiale | |
| 4 : Pérenniser les sites de migration et maintenir la gestion adaptée | |
| B : Intégrer les objectifs du Plan International d’Actions dans la stratégie nationale | 5 : Déployer un indice représentatif du succès global de la reproduction |
| 6 : Contribuer à la protection des zones d’hivernage | |
| C : Animer et mutualiser les connaissances et les actions de conservation | 7 : Valoriser et diffuser les acquis du PNA |
| 8 : Animer le PNA et collaborer avec les autres PNA |